PROUST ET LES SIGNES, GILLES DELEUZE (Quadrige)
Dans son essai de 1964, Deleuze distingue quatre types de signes chez Proust :
-les signes mondains ou signes du vide (les salons)
-les signes amoureux ou signes trompeurs (Swann/Odette puis le Narrateur/Albertine)
-les signes matériels ou sensibles (la madeleine), également trompeurs
-les signes de l’art, enfin, les plus aboutis (la révélation finale du Temps retrouvé)
Il opère une hiérarchie entre ces signes qui correspond à une gradation dans la prise de conscience de la “vocation” du narrateur dans l’espace même du roman. Ce n’est certainement pas chez les Guermantes ni avec les jeunes filles en fleurs qu’il trouvera l’éveil spirituel – même s’ils participent, à leur manière, à l’élaboration d’une oeuvre. Quant à la première extase, celle de la madeleine, elle est trompeuse car, si elle crée de la réminiscence, c’est uniquement d’ordre matériel. La madeleine rappelle Combray, c’est-à-dire un espace physique mais le narrateur ne parvient pas à recréer les sensations éprouvées à Combray, un geste artistique qu’il parviendra finalement à accomplir avec les souvenirs de Venise à la fin du Temps retrouvé. Deleuze souligne aussi la hiérarchie proustienne entre « le couple traditionnel de l’amitié de la philosophie » auquel il oppose « le couple plus obscur formé par l’art et par l’amour”.
Les signes qui ont cours dans un milieu sont dénués de valeur dans un autre. Ainsi, Swann, reçu chez des altesses, est perçu comme un “aventurier” dans le petit cercle des Verdurin que sa passion toxique pour Odette va le pousser à fréquenter. Autre exemple dans le même cénacle : Cottard, docteur prestigieux, pertinent dans ses diagnostics (capable donc d’interpréter les “signes de la maladie”) se révèle inapte dans les dîners à se faire remarquer autrement que par des calembours imbéciles. Être sensible aux signes, considérer le monde comme des hiéroglyphes à déchiffrer est un des dons de Proust pour Deleuze. Le philosophe revient également sur le pouvoir du nom chez Proust, thème central, qui en fait le plus auteur des auteurs, car le nom, l’essence du nom, vaut bien davantage que l’objet ou la personne qui l’incarne. Le nom de Guermantes vaut mieux que lesGuermantes et même existe davantage, de même que Balbec existait davantage avant que le narrateur y mît les pieds, Balbec et son église persane, si décevante en réalité. Ainsi, la duchesse de Guermantes est parée pour le narrateur d’un grand prestige parce qu’elle doit posséder, croit-il, “le secret de son nom”. Il se la représente « baignant comme dans un coucher de soleil dans la lumière orange qui émane de cette dernière syllabe -antes”. le corps de la duchesse de Guermantes doit forcément contenir pour lui “la vie inconcevable que ce nom signifiait”. Déchéance d’Oriane qui d’un nom devient un amour pour finir en simple femme du monde. Il faudra quelques milliers de pages pour que le nom de Guermantes se refasse une virginité, qu’il évoque à nouveau au narrateur les sensations ressenties enfant devant le vitrail de Gilbert le Mauvais. Seul dans sa chambre avec la lanterne magique, le nom signifiait encore une féodalité glorieuse, l’histoire de Geneviève de Brabant alors que les Guermantes réels ne sont que des fins de race. Tu es nom et tu redeviendras nom. Ainsi Odette redevient « la dame en rose » dans une enfance retrouvée à volonté baudelairienne représentant “la révolution qu’on accomplit toujours autour de soi mais aussi autour des autres”.
Plus loin : « Quand il voit puis qu’il connaît Madame de Guermantes, il s’aperçoit qu’elle ne contient pas le secret du sens de son nom. Son visage et son corps ne sont pas colorés par la teinte des syllabes. Que faire pour compenser la déception ? Devenir personnellement sensible à des signes moins profonds, mais mieux appropriés au charme de la duchesse, grâce au jeu des associations d’idées qu’elle suscite en nous. » C’est à une sorte d’éveil bouddhiste que nous invite la Recherche, une capacité à voir au-delà du matériel et à chercher une réalité indépendante de la réalité extérieure. « Combien il est difficile », note Deleuze, « dans chaque domaine, de renoncer à cette croyance à une réalité extérieure. Les signes sensibles nous en empêchent et nous invitent à chercher leur sens dans l’objet (…) et même si nous avons vaincu les illusions objectivistes dans la plupart des domaines, elles subsistent encore en Art, où nous continuons à croire qu’il faudrait savoir écouter, regarder, décrire, s’adresser à l’objet, le décomposer, le triturer pour en extraire une vérité”
Pourquoi les signes de l’art sont-ils les plus puissants, demande Deleuze ? Parce ce qu’eux seuls accèdent à l’essence. Seuls les signes de l’art sont immatériels. Ainsi, la petite phrase de Vinteuil certes s’échappe du piano et du violon, sans doute peut être décomposée matériellement en cinq notes très rapprochées dont deux reviennent régulièrement mais, précise Deleuze, comme chez Platon où 3 + 2 n’explique rien, le piano n’est là que comme image spatiale d’un clavier d’une tout autre nature et les notes comme « la pensée sonore » d’une entité toute spirituelle. De même, pour l’art de la Berma, on pense aux théories théâtrales d’Artaud chez qui chaque mouvement dans l’espace n’est que l’émanation physique d’un principe spirituel, chez qui l’or des alchimistes du Moyen-Âge n’est que la version basse de l’or transcendantal des philosophes de la même période. Si la Berma se sert de sa voix et de ses bras, au lieu de témoigner des connexités musculaires, ils forment un corps transparent qui réfracte une pure essence et c’est précisément cette unité du signe et du sens tel qu’elle est révélée dans l’œuvre d’art.
La supériorité de l’art sur la vie consiste en ce que tous les signes que nous rencontrons dans la vie sont encore des signes matériels. À cet égard, pour Deleuze, Proust se révèle leibnizien : les essences sont de véritables monades, “chaque point de vue renvoyant lui-même à une qualité ultime au fond de la monade”. C’est pourquoi, continue-t-il, “l’amitié établit jamais que de fausses communications fondées sur des malentendus”. Même la fréquentation d’êtres supérieurs comme Elstir ou Bergotte n’apporte rien au narrateur en comparaison de l’amour d’Albertine.
Proust est bien sûr platonicien et chez lui l’idée se place toujours au-dessus de l’objet. Faut-il en conclure, demande Deleuze, que l’essence est subjective et que la différence réside entre sujets plutôt qu’entre objets ? Ce serait négliger les textes où Proust traite les essences comme des idées platoniciennes et leur confère une réalité indépendante. Même Vinteuil a dévoilé la phrase plus qu’il ne l’a créée de même que l’écrivain a pour rôle d’être un “traducteur de la vie”. Les essences peut-être se sont-elles même emprisonnées et se sont développées dans ces âmes qu’elles individualisent. Ce sont nos otages : elles meurent si nous mourrons mais si elles sont éternelles, elles nous confèrent l’éternité. Elles rendent donc la mort moins probable ; la seule preuve, la seule chance est esthétique. Aussi deux questions sont-elles fondamentalement liées : les questions de la réalité de l’art et de la validité de l’éternité de l’âme. Devient symbolique à cet égard la mort de Bergotte devant le petit pan de mur jaune de Vermeer : « Dans une céleste balance lui apparaissaient, chargeant l’un des plateaux, sa propre vie, tandis que l’autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu’il avait imprudemment donné le premier pour le second… Un nouveau coup l’abattit…. Il était mort. Mort à jamais ? Qui peut le dire ? »
François Audouy, 8/10/2024
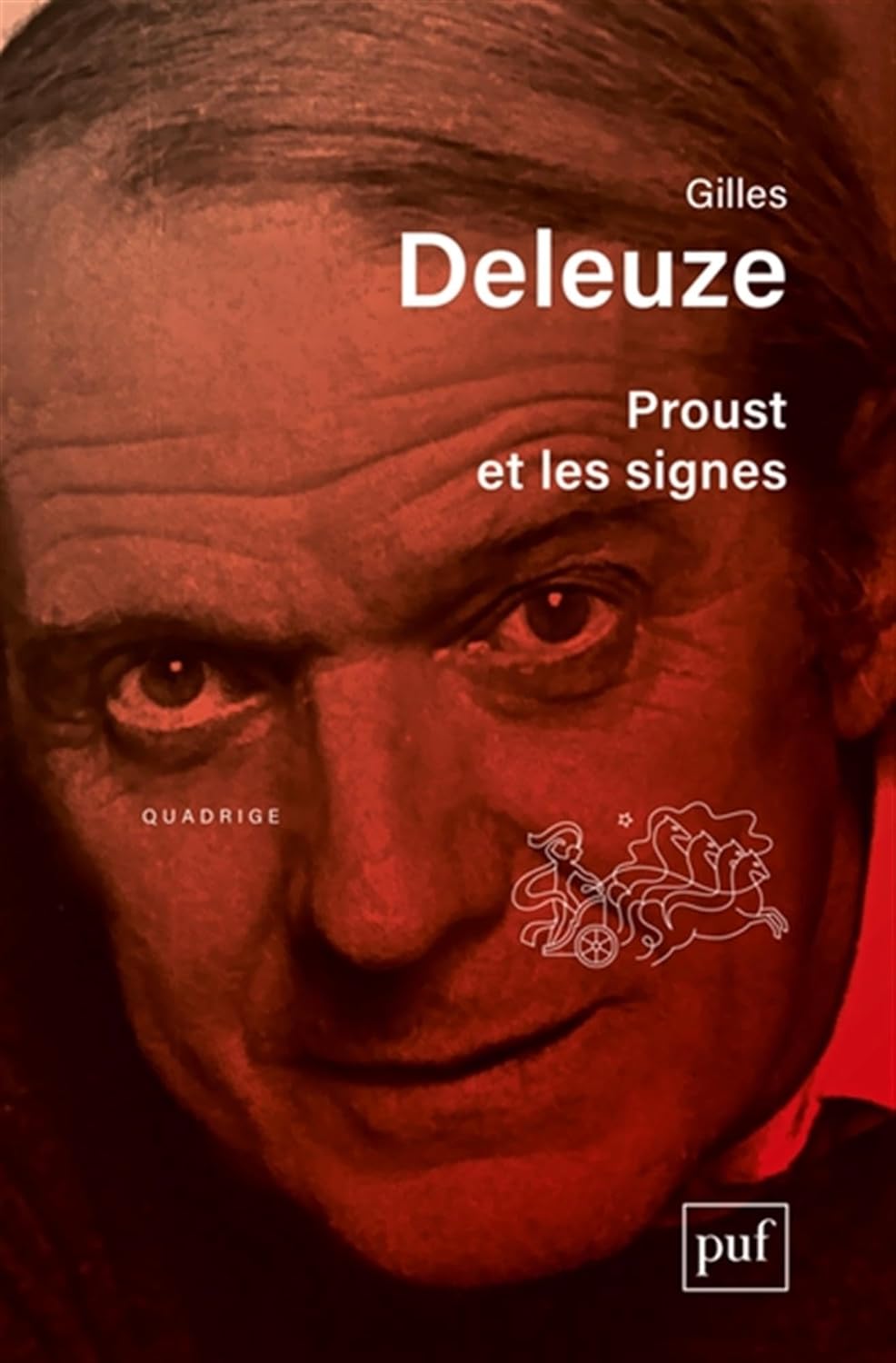
Laisser un commentaire